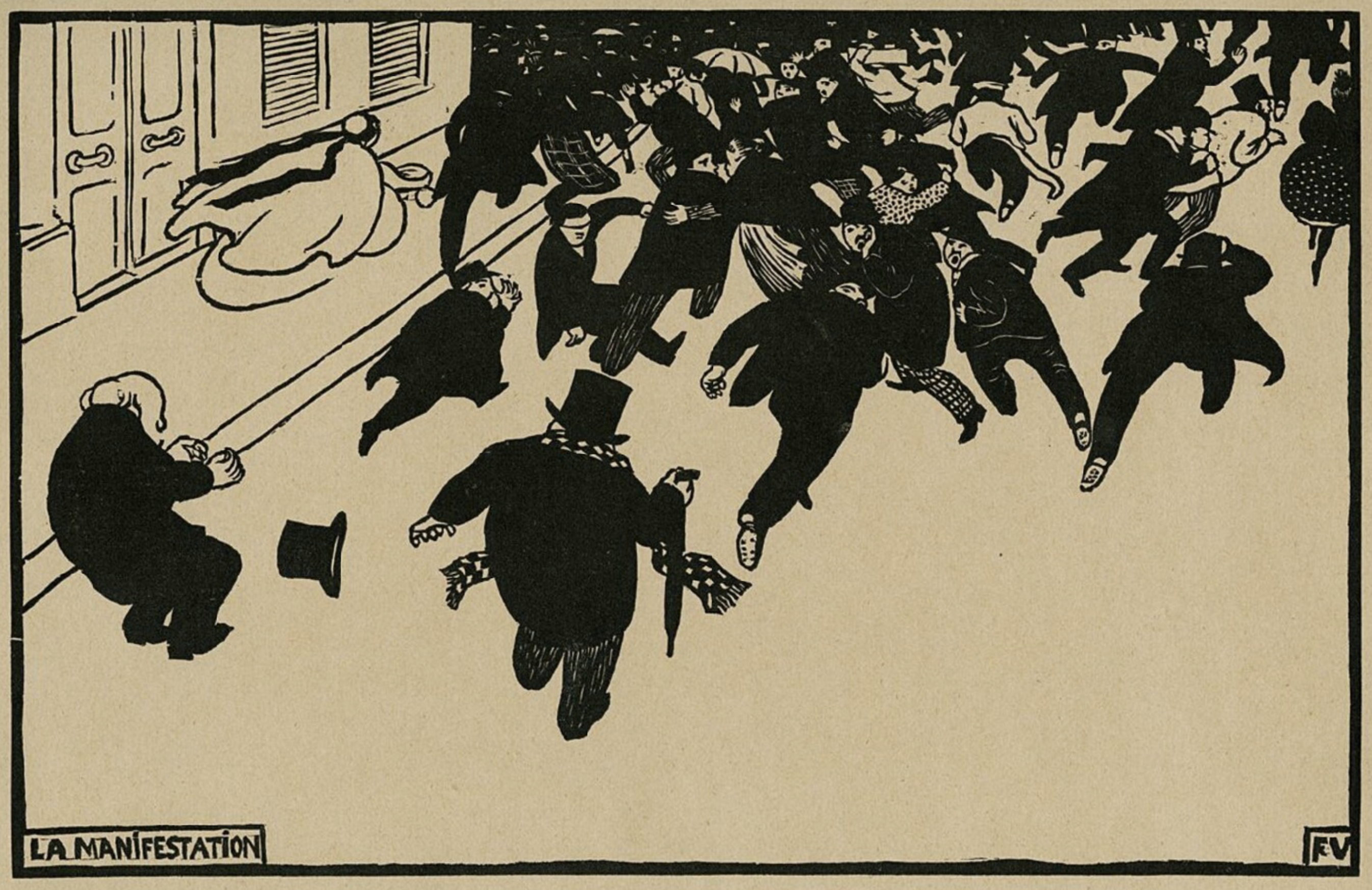De la misère intellectuelle et morale en Suisse romande
Dans un extrait visionnaire datant de 1981, Jan Marejko* et Éric Werner analysent avec lucidité les rapports de force en Suisse entre le peuple, les notables et l’intelligentsia. Un regard précieux pour comprendre la trahison des élites d’hier… et d’aujourd’hui.
Il existe trois grandes forces politiques en Suisse :
1) les notables en place (libéraux, radicaux, socialistes, démocrates-chrétiens, agrariens, etc.) qui se partagent le pouvoir ;
2) les intellectuels, jouant le rôle de contre-pouvoir ;
3) le peuple, foncièrement conservateur et attaché à ses traditions.
Les notables multiplient les courbettes en direction de l’intelligentsia (maîtresse des médias), et celle-ci fait de même en direction du peuple. Mais le peuple déteste les intellectuels, qu’il accuse de parasitisme.
En Suisse, contrairement à ce qui se passe ailleurs, le peuple ne peut que difficilement être mis hors-jeu. On est fréquemment obligé de le consulter. Il peut dire non à certains projets. C’est ce qu’on appelle la démocratie directe (objet de moquerie de l’intelligentsia). La fonction première de la démocratie directe est de prévenir toute capitulation des notables devant les intellectuels. Les notables n’ont pas seulement pour interlocuteurs les intellectuels, mais le peuple, très hostile aux intellectuels. C’est une situation tout à fait particulière à la Suisse. Si les deux seules forces en présence étaient les notables et les intellectuels (comme c’est le cas souvent ailleurs), ceux-ci seraient à peu près maîtres du jeu. Mais le fait que le peuple ait son mot à dire complique les données. De même que l’intelligentsia fait fonction de contre-pouvoir par rapport aux notables, le peuple fait fonction de contre-pouvoir par rapport à l’intelligentsia.
Entre le peuple, les notables et l’intelligentsia, tous les cas de figure sont envisageables :
1) une alliance entre le peuple et l’intelligentsia contre les notables ;
2) une alliance entre le peuple et les notables contre l’intelligentsia ;
3) une alliance entre les notables et l’intelligentsia contre le peuple.
La première formule ne s’est jamais jusqu’ici concrétisée, et à vue humaine ne se concrétisera jamais. La seconde a longtemps constitué la pierre angulaire de la politique helvétique. Mais elle se trouve aujourd’hui remise en question. On note en effet depuis un certain nombre d’années une assez sensible évolution dans l’attitude des notables, manifestement tentés par un rapprochement avec l’intelligentsia. Ce rapprochement s’est matérialisé pour la première fois il y a une dizaine d’années, lors du débat sur la politique d’immigration, suscité par l’initiative Schwarzenbach. Cette initiative, taxée de « xénophobe », fut combattue par la classe politique unanime alliée aux intellectuels et aux Églises. Elle ne fut repoussée qu’à une courte majorité.
Autre terrain de convergence : la politique étrangère, où les notables ont embouché la trompette de l’adhésion à l’ONU (refusée en revanche par le peuple) et tiennent un langage emprunté pour l’essentiel à la rhétorique de l’intelligentsia.Jan Marejko et Éric Werner
La formule correspondant le mieux à la situation actuelle serait donc la troisième (alliance des notables et de l’intelligentsia contre le peuple).
De la misère intellectuelle et morale en Suisse romande, 1981
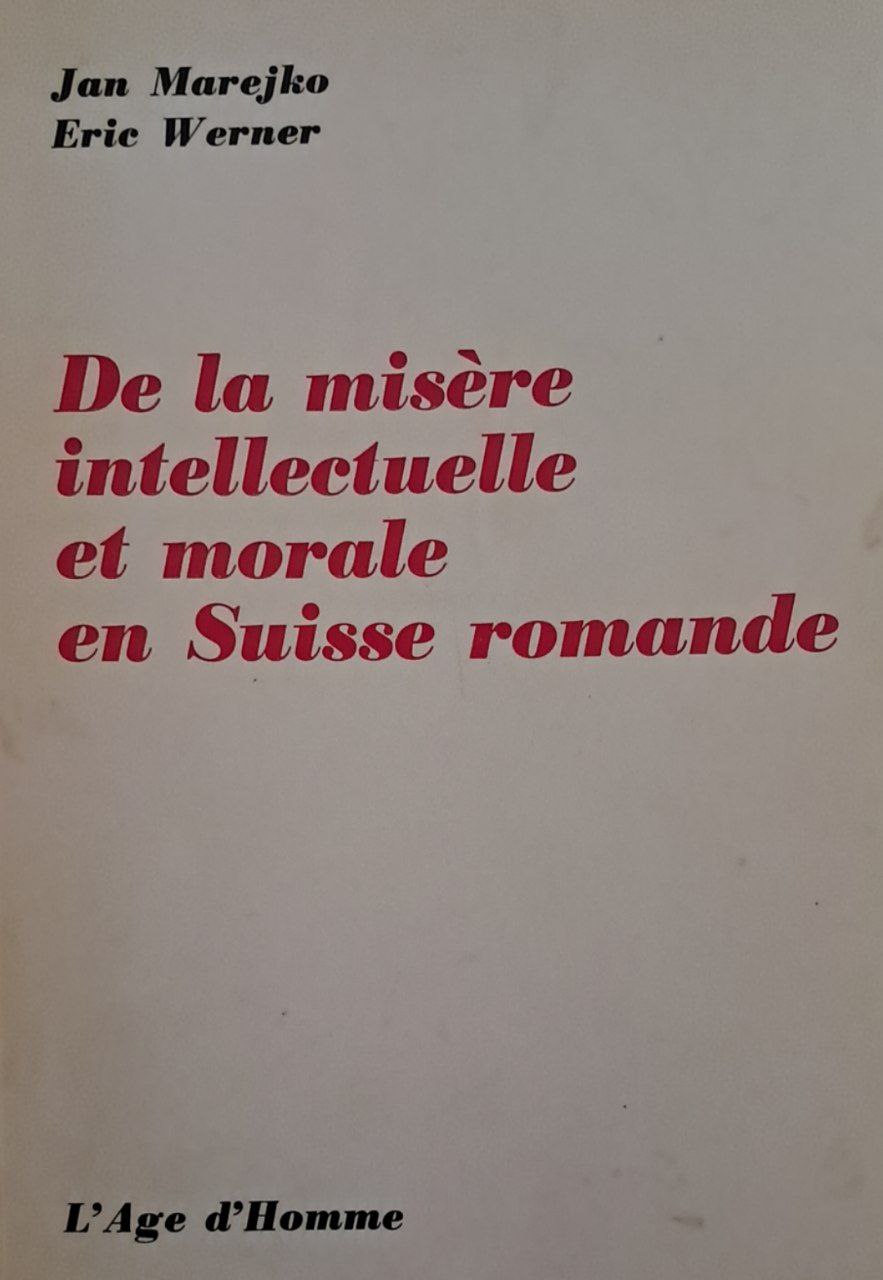
* https://resistance-helvetique.org/citations/citation-de-jan-marejko/
Image d’illustration : La Manifestation, de Félix Vallotton